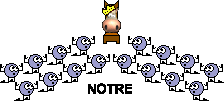Je ne pense pas qu'on puisse qualifier le 19C27 de "semi-inox". Certes, la résistance à la corrosion est moindre que des aciers plus pauvre en carbone (en particuliers hypoeutectoïdes comme le 12C27 ou le Z40), mais si le traitement thermique et la finition sont correctement effectués, ça ne devrait pas vraiment poser problème pour une utilisation domestique/urbaine normale.
Le truc, c'est qu'il est assez facile de rogner sur les étapes de finition sans que ça ne soit voyant. Par exemple, à Thiers, il y a ce qu'on appelle le "rillassage" (orthographe très approximative) qui peut servir d'étape unique de finition après le brut d'émouture (enfin, un brut assez fin tout de même, certaines meules le permettent maintenant), laissant un aspect satiné difficilement différentiable pour l'oeil non averti d'un satiné fait à la brosse sur une lame préalablement polie. En plus, en industriel, hormis pour faire du poli glace (ou pour des trucs pas chers passés par centaines dans les machines à polir en long), on croise rarement les traits, on reste en travers, ce qui fait que de gros et profonds traits d'émouture peuvent en fait rester, en étant simplement "dissimulés" au milieu de traits plus fins. Ces gros traits, sur des aciers un peu limite au niveau résistance à la corrosion comme le 19C27, peuvent vraiment servir d'amorce à une oxydation de type pitting. En supposant le traitement thermique correctement effectué, si le satiné était fait sur un poli glace (ou tout au moins une finition sisal avec croisements des traits), le 19C27 n'aurait pas de problème d'oxydation en conditions normales d'utilisation.
Semi inox
71 messages • Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Semi inox
Je ne suis pas spécialiste mais chez moi mes français en 19c27 rouillent aussi facilement que mes bench en D2, après p'tet que c'est de la merde hein... 'fin c'est toi qui le dit quoi ou alors il faut expliquer ce que sont les conditions "normales".
-

Fouin'toc - Chimie shake
- Messages: 14591
- Inscrit le: 20 Mai 2008 12:17
- Localisation: Haut Languedoc
Re: Semi inox
Ben pas chez toi justement  , jamais fais rouiller du 19C27, du D2 oui. Je suppose que l'air marin de ton coin y est pour beaucoup
, jamais fais rouiller du 19C27, du D2 oui. Je suppose que l'air marin de ton coin y est pour beaucoup
-

Lorgar - Loreflet de lame
- Messages: 10236
- Inscrit le: 25 Avr 2007 16:07
- Localisation: Toulouse
Re: Semi inox
19C27: 0.95%C, 13.5%Cr, 0.65%Mn
D2: 1.5%C, 12%Cr, 0.9%V, 0.8%Mo
carbure de vanadium: VC (il faut un atome de vanadium pour "fixer" un atome de carbone)
carbure de molybdène: Mo2C (deux atomes de molybdène pour un atome de carbone)
carbure de manganèse: Mn3C
carbures de chrome: Cr3C2, Cr7C3, Cr23C6
Il est certain que le D2 contient plus d'éléments d'alliages carburigènes susceptibles de fixer le carbone, laissant relativement plus de chrome libre que dans le 12C27. Mais il faut cependant garder en tête que le carbone est aussi très bien au milieu du fer, c'est au dessus de l'eutecoïde (le fameux 0.77% du diagramme fer-carbone) qu'il est surnuméraire et "fonce" de lui-même former des carbures dès qu'il en a l'occasion (la dynamique de ce phénomène de formation des carbures lors du refroidissement après austénitisation est particulièrement complexe). En pratique, il est cependant quasiment impossible d'arracher le carbone en solution dans le fer en dessous de 0.4% lors d'une trempe. Sans vouloir trop m'avancer, je pense que le type de carbure formé dépend de la vitesse de refroidissement: plus il est brutal, moins les atomes ont le temps de bouger pour se recombiner, donc plus les carbures formés seront petits (donc prédominance du Cr3C2 et Cr7C3, beaucoup moins "gourmands" en chrome que le Cr23C6).
On voit bien que, selon le traitement thermique (à finition similaire), on peut vraiment inverser l'ordre dans la résistance à la corrosion. Si on austénitise le 19C27 chaud (mais pas trop longtemps afin de contrôler le grossissement du grain), de façon à mettre en solution tous les gros carbures gourmands en chrome (lors du recuit de l'acier, le Cr23C6 a tout le temps de se former), et qu'on fait une trempe vigoureuse (à l'huile agitée), les petits carbures se forment en priorité, et assez difficilement d'ailleurs, ce qui laisse un maximum de chrome "libre", celui qui assure la résistance à la corrosion. Si au contraire, pas peur (légitime) de grossissement du grain, on austénitise assez bas en température, qu'on laisse chauffer longtemps (ce qui est le cas pour la trempe en paquets, ce qui fait que malgré toutes les précautions qu'on prend, les lames qui chauffent le plus vite voient leur grain grossir) qu'on trempe comme on peu (si on fait de la trempe en paquet, de même que la montée en température n'est pas la même pour toutes les lames, idem du refroidissement, plus difficile pour les lames qui sont le plus au centre), alors on a des chances accrues que les gros carbures de chrome se soient conservés, ou que d'autres se soient formés lors d'un refroidissement trop lent, d'où une résistance à la corrosion diminuée.
Pour le D2, c'est pareil. Ce dont on est cependant certain, c'est que les carbures de vanadium se forment très vite, et ceux de molybdène à peine plus lentement, "suçant" ainsi une partie du carbone avant les gros carbures de chrome. Je n'ai pas les connaissances pour caractériser la dynamique de la formation de ces carbures-là, et l'ampleur de la "succion", je pense qu'elle est à peu près proportionnelle à la probabilité, dans un volume donné, que les éléments composants du carbures soient présents (par exemple, comme il y a 0.9% de V et 1.5% de C, et que le carbure est VC, la probabilité est de 0.009x0.015=0.000135, pour le carbure Cr3C2, étant donné qu'il y a 12% de Cr, 0.12/3x0.015/2=0.0003, mais pour le carbure Cr7C3 0.12/7*0.015/3=0.000083, et encore il faudrait travailler en moles, pas en pourcentages massiques). Mais il est certain qu'on épuise ni ces deux éléments carburigènes, ni le carbone (qui en réalité n'est pas dans le vide, mais "accroché" dans le réseau crystalin du fer et est aussi tenté de former des carbures avec le fer Fe3C, soit isolément, généralement aux joints de grains, soit au sein de structures plus complexes comme la perlite), que ce soit aussi bien lors du recuit qu'à la trempe. Je pense qu'ils sont aussi plus difficiles à désagréger, lors de l'austénitisation, que les gros carbures que peut former le chrome.
A la limite, le D2, grâce aux éléments d'alliage capteurs de carbone, risque moins de voir sa résistance à la corrosion varier à cause du traitement thermique que le 19C27. Cependant, alors que le taux tout de même assez élevé de chrome ne diminue pas beaucoup la dynamique de formation du petit carbure Cr3C2 facile à former (puisque de l'autre coté il y a aussi plus de carbone), ça fait tout de même moins de chrome libre restant pour l'inoxydabilité en cas de trempe vigoureuse empêchant la formation des gros carbures de chrome (dans le 19C27). Bref, le D2 a un niveau de résistance à la corrosion variant très peu en fonction du traitement thermique, alors que le 19C27 y est très sensible: austénitisé et trempé idéalement il a une meilleure inoxydabilité (on ne peut cependant pas espérer atteindre celle des aciers à "faible" taux de carbone), mais dès qu'on s'en écarte, les conséquences au niveau de la résistance à la corrosion peuvent être dramatiques. Cela se surajoute aux questions d'état de surface. Tout celà est intimement lié aux process de production, donc, et dépasse de très loin les caractérisations simplistes sur la seule base de la composition de l'acier, du moins pour ces nuances "limites" où le carbone "surnuméraire" peut ou peut ne pas former de gros carbures gourmands en chrome.
(chbim, ça c'est du pavé! Je suis fier de moi, tiens)
EDIT: et oui, c'est encore sans compter l'environnement. Je connaissais un mec qui avait les mains tellement acides, par exemple, que même pas une heure après qu'il ait posé ses doigts sur une lame carbone polie glace, on retrouvait dessus ses empreintes digitales en rouille brune (à titre de comparaison, j'ai une lame en C75 polie glace qui est restée stockée au fond d'une cantine pendant 5ans, elle est à peine piquée). Composition + traitement thermique + état de surface + environnement, ça fait un nombre colossal de facteurs.
D2: 1.5%C, 12%Cr, 0.9%V, 0.8%Mo
carbure de vanadium: VC (il faut un atome de vanadium pour "fixer" un atome de carbone)
carbure de molybdène: Mo2C (deux atomes de molybdène pour un atome de carbone)
carbure de manganèse: Mn3C
carbures de chrome: Cr3C2, Cr7C3, Cr23C6
Il est certain que le D2 contient plus d'éléments d'alliages carburigènes susceptibles de fixer le carbone, laissant relativement plus de chrome libre que dans le 12C27. Mais il faut cependant garder en tête que le carbone est aussi très bien au milieu du fer, c'est au dessus de l'eutecoïde (le fameux 0.77% du diagramme fer-carbone) qu'il est surnuméraire et "fonce" de lui-même former des carbures dès qu'il en a l'occasion (la dynamique de ce phénomène de formation des carbures lors du refroidissement après austénitisation est particulièrement complexe). En pratique, il est cependant quasiment impossible d'arracher le carbone en solution dans le fer en dessous de 0.4% lors d'une trempe. Sans vouloir trop m'avancer, je pense que le type de carbure formé dépend de la vitesse de refroidissement: plus il est brutal, moins les atomes ont le temps de bouger pour se recombiner, donc plus les carbures formés seront petits (donc prédominance du Cr3C2 et Cr7C3, beaucoup moins "gourmands" en chrome que le Cr23C6).
On voit bien que, selon le traitement thermique (à finition similaire), on peut vraiment inverser l'ordre dans la résistance à la corrosion. Si on austénitise le 19C27 chaud (mais pas trop longtemps afin de contrôler le grossissement du grain), de façon à mettre en solution tous les gros carbures gourmands en chrome (lors du recuit de l'acier, le Cr23C6 a tout le temps de se former), et qu'on fait une trempe vigoureuse (à l'huile agitée), les petits carbures se forment en priorité, et assez difficilement d'ailleurs, ce qui laisse un maximum de chrome "libre", celui qui assure la résistance à la corrosion. Si au contraire, pas peur (légitime) de grossissement du grain, on austénitise assez bas en température, qu'on laisse chauffer longtemps (ce qui est le cas pour la trempe en paquets, ce qui fait que malgré toutes les précautions qu'on prend, les lames qui chauffent le plus vite voient leur grain grossir) qu'on trempe comme on peu (si on fait de la trempe en paquet, de même que la montée en température n'est pas la même pour toutes les lames, idem du refroidissement, plus difficile pour les lames qui sont le plus au centre), alors on a des chances accrues que les gros carbures de chrome se soient conservés, ou que d'autres se soient formés lors d'un refroidissement trop lent, d'où une résistance à la corrosion diminuée.
Pour le D2, c'est pareil. Ce dont on est cependant certain, c'est que les carbures de vanadium se forment très vite, et ceux de molybdène à peine plus lentement, "suçant" ainsi une partie du carbone avant les gros carbures de chrome. Je n'ai pas les connaissances pour caractériser la dynamique de la formation de ces carbures-là, et l'ampleur de la "succion", je pense qu'elle est à peu près proportionnelle à la probabilité, dans un volume donné, que les éléments composants du carbures soient présents (par exemple, comme il y a 0.9% de V et 1.5% de C, et que le carbure est VC, la probabilité est de 0.009x0.015=0.000135, pour le carbure Cr3C2, étant donné qu'il y a 12% de Cr, 0.12/3x0.015/2=0.0003, mais pour le carbure Cr7C3 0.12/7*0.015/3=0.000083, et encore il faudrait travailler en moles, pas en pourcentages massiques). Mais il est certain qu'on épuise ni ces deux éléments carburigènes, ni le carbone (qui en réalité n'est pas dans le vide, mais "accroché" dans le réseau crystalin du fer et est aussi tenté de former des carbures avec le fer Fe3C, soit isolément, généralement aux joints de grains, soit au sein de structures plus complexes comme la perlite), que ce soit aussi bien lors du recuit qu'à la trempe. Je pense qu'ils sont aussi plus difficiles à désagréger, lors de l'austénitisation, que les gros carbures que peut former le chrome.
A la limite, le D2, grâce aux éléments d'alliage capteurs de carbone, risque moins de voir sa résistance à la corrosion varier à cause du traitement thermique que le 19C27. Cependant, alors que le taux tout de même assez élevé de chrome ne diminue pas beaucoup la dynamique de formation du petit carbure Cr3C2 facile à former (puisque de l'autre coté il y a aussi plus de carbone), ça fait tout de même moins de chrome libre restant pour l'inoxydabilité en cas de trempe vigoureuse empêchant la formation des gros carbures de chrome (dans le 19C27). Bref, le D2 a un niveau de résistance à la corrosion variant très peu en fonction du traitement thermique, alors que le 19C27 y est très sensible: austénitisé et trempé idéalement il a une meilleure inoxydabilité (on ne peut cependant pas espérer atteindre celle des aciers à "faible" taux de carbone), mais dès qu'on s'en écarte, les conséquences au niveau de la résistance à la corrosion peuvent être dramatiques. Cela se surajoute aux questions d'état de surface. Tout celà est intimement lié aux process de production, donc, et dépasse de très loin les caractérisations simplistes sur la seule base de la composition de l'acier, du moins pour ces nuances "limites" où le carbone "surnuméraire" peut ou peut ne pas former de gros carbures gourmands en chrome.
(chbim, ça c'est du pavé! Je suis fier de moi, tiens)
EDIT: et oui, c'est encore sans compter l'environnement. Je connaissais un mec qui avait les mains tellement acides, par exemple, que même pas une heure après qu'il ait posé ses doigts sur une lame carbone polie glace, on retrouvait dessus ses empreintes digitales en rouille brune (à titre de comparaison, j'ai une lame en C75 polie glace qui est restée stockée au fond d'une cantine pendant 5ans, elle est à peine piquée). Composition + traitement thermique + état de surface + environnement, ça fait un nombre colossal de facteurs.
-

Madnumforce - Kaliméro
- Messages: 1092
- Inscrit le: 17 Mai 2010 20:18
Re: Semi inox
Lorgar a écrit:Ben pas chez toi justement, jamais fais rouiller du 19C27, du D2 oui. Je suppose que l'air marin de ton coin y est pour beaucoup
En effet, et je suis sûr que certains te diront qu'ils n'ont pas vu de D2 rouiller, d'où ma question sur les conditions "normales".
Madnum, désolé mais je n'ai pas lu ton pavé, il est un peu tard, même chez moi...
-

Fouin'toc - Chimie shake
- Messages: 14591
- Inscrit le: 20 Mai 2008 12:17
- Localisation: Haut Languedoc
Re: Semi inox
Inoxidable n'existe pas vraiment , presque tout s'oxide.
Le D2 et le D3 rouillent mais pas si vite.
Le D2 et le D3 rouillent mais pas si vite.
- deovolens
- XX Hell
- Messages: 6729
- Inscrit le: 17 Sep 2007 21:23
- Localisation: Belgique
Re: Semi inox
Madnumforce a écrit:(chbim, ça c'est du pavé! Je suis fier de moi, tiens)
Tu peux. Il est très bien ton pavé.
Je vais le relire plusieurs fois par contre...
-

G-M - honky Tonc-man
- Messages: 24573
- Inscrit le: 28 Aoû 2012 07:52
- Localisation: Jean Paul Sarthe
Re: Semi inox
G-M a écrit:Madnumforce a écrit:(chbim, ça c'est du pavé! Je suis fier de moi, tiens)
Tu peux. Il est très bien ton pavé.
Je vais le relire plusieurs fois par contre...
Super intéressant, à lire et relire avec l'aide Google de temps en temps (pour moi !). Merci pour le pavé !
C’est pas permis d’être aussi inintelligent que toi, tu sais ce que ça veut dire « inintelligent », espèce de con ?
R. Queneau - Zazie dans le métro
R. Queneau - Zazie dans le métro
-
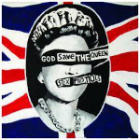
philzgood - Messages: 5047
- Inscrit le: 26 Aoû 2013 16:48
- Localisation: Paris
Re: Semi inox
Madnumforce a écrit:19C27: 0.95%C, 13.5%Cr, 0.65%Mn
D2: 1.5%C, 12%Cr, 0.9%V, 0.8%Mo
carbure de vanadium: VC (il faut un atome de vanadium pour "fixer" un atome de carbone)
carbure de molybdène: Mo2C (deux atomes de molybdène pour un atome de carbone)
carbure de manganèse: Mn3C
carbures de chrome: Cr3C2, Cr7C3, Cr23C6
Il est certain que le D2 contient plus d'éléments d'alliages carburigènes susceptibles de fixer le carbone, laissant relativement plus de chrome libre que dans le 12C27. Mais il faut cependant garder en tête que le carbone est aussi très bien au milieu du fer, c'est au dessus de l'eutecoïde (le fameux 0.77% du diagramme fer-carbone) qu'il est surnuméraire et "fonce" de lui-même former des carbures dès qu'il en a l'occasion (la dynamique de ce phénomène de formation des carbures lors du refroidissement après austénitisation est particulièrement complexe). En pratique, il est cependant quasiment impossible d'arracher le carbone en solution dans le fer en dessous de 0.4% lors d'une trempe. Sans vouloir trop m'avancer, je pense que le type de carbure formé dépend de la vitesse de refroidissement: plus il est brutal, moins les atomes ont le temps de bouger pour se recombiner, donc plus les carbures formés seront petits (donc prédominance du Cr3C2 et Cr7C3, beaucoup moins "gourmands" en chrome que le Cr23C6).
On voit bien que, selon le traitement thermique (à finition similaire), on peut vraiment inverser l'ordre dans la résistance à la corrosion. Si on austénitise le 19C27 chaud (mais pas trop longtemps afin de contrôler le grossissement du grain), de façon à mettre en solution tous les gros carbures gourmands en chrome (lors du recuit de l'acier, le Cr23C6 a tout le temps de se former), et qu'on fait une trempe vigoureuse (à l'huile agitée), les petits carbures se forment en priorité, et assez difficilement d'ailleurs, ce qui laisse un maximum de chrome "libre", celui qui assure la résistance à la corrosion. Si au contraire, pas peur (légitime) de grossissement du grain, on austénitise assez bas en température, qu'on laisse chauffer longtemps (ce qui est le cas pour la trempe en paquets, ce qui fait que malgré toutes les précautions qu'on prend, les lames qui chauffent le plus vite voient leur grain grossir) qu'on trempe comme on peu (si on fait de la trempe en paquet, de même que la montée en température n'est pas la même pour toutes les lames, idem du refroidissement, plus difficile pour les lames qui sont le plus au centre), alors on a des chances accrues que les gros carbures de chrome se soient conservés, ou que d'autres se soient formés lors d'un refroidissement trop lent, d'où une résistance à la corrosion diminuée.
Pour le D2, c'est pareil. Ce dont on est cependant certain, c'est que les carbures de vanadium se forment très vite, et ceux de molybdène à peine plus lentement, "suçant" ainsi une partie du carbone avant les gros carbures de chrome. Je n'ai pas les connaissances pour caractériser la dynamique de la formation de ces carbures-là, et l'ampleur de la "succion", je pense qu'elle est à peu près proportionnelle à la probabilité, dans un volume donné, que les éléments composants du carbures soient présents (par exemple, comme il y a 0.9% de V et 1.5% de C, et que le carbure est VC, la probabilité est de 0.009x0.015=0.000135, pour le carbure Cr3C2, étant donné qu'il y a 12% de Cr, 0.12/3x0.015/2=0.0003, mais pour le carbure Cr7C3 0.12/7*0.015/3=0.000083, et encore il faudrait travailler en moles, pas en pourcentages massiques). Mais il est certain qu'on épuise ni ces deux éléments carburigènes, ni le carbone (qui en réalité n'est pas dans le vide, mais "accroché" dans le réseau crystalin du fer et est aussi tenté de former des carbures avec le fer Fe3C, soit isolément, généralement aux joints de grains, soit au sein de structures plus complexes comme la perlite), que ce soit aussi bien lors du recuit qu'à la trempe. Je pense qu'ils sont aussi plus difficiles à désagréger, lors de l'austénitisation, que les gros carbures que peut former le chrome.
A la limite, le D2, grâce aux éléments d'alliage capteurs de carbone, risque moins de voir sa résistance à la corrosion varier à cause du traitement thermique que le 19C27. Cependant, alors que le taux tout de même assez élevé de chrome ne diminue pas beaucoup la dynamique de formation du petit carbure Cr3C2 facile à former (puisque de l'autre coté il y a aussi plus de carbone), ça fait tout de même moins de chrome libre restant pour l'inoxydabilité en cas de trempe vigoureuse empêchant la formation des gros carbures de chrome (dans le 19C27). Bref, le D2 a un niveau de résistance à la corrosion variant très peu en fonction du traitement thermique, alors que le 19C27 y est très sensible: austénitisé et trempé idéalement il a une meilleure inoxydabilité (on ne peut cependant pas espérer atteindre celle des aciers à "faible" taux de carbone), mais dès qu'on s'en écarte, les conséquences au niveau de la résistance à la corrosion peuvent être dramatiques. Cela se surajoute aux questions d'état de surface. Tout celà est intimement lié aux process de production, donc, et dépasse de très loin les caractérisations simplistes sur la seule base de la composition de l'acier, du moins pour ces nuances "limites" où le carbone "surnuméraire" peut ou peut ne pas former de gros carbures gourmands en chrome.
(chbim, ça c'est du pavé! Je suis fier de moi, tiens)
EDIT: et oui, c'est encore sans compter l'environnement. Je connaissais un mec qui avait les mains tellement acides, par exemple, que même pas une heure après qu'il ait posé ses doigts sur une lame carbone polie glace, on retrouvait dessus ses empreintes digitales en rouille brune (à titre de comparaison, j'ai une lame en C75 polie glace qui est restée stockée au fond d'une cantine pendant 5ans, elle est à peine piquée). Composition + traitement thermique + état de surface + environnement, ça fait un nombre colossal de facteurs.
C'est un peu de la vulgarisation scientifique parce que tu oublies la dynamique des fluides qui s' applique a cette temperature mais l'idée y est.…


Ce couteau : comme icone, objet de discussion et signe de l'inutilité qui rend notre esprit heureux je te le conseille et pourqoui pas la vie est déjà triste et réaliste assez.
-

freddy1 - Jeb's Dîme
- Messages: 55200
- Inscrit le: 01 Nov 2006 19:29
- Localisation: sceaux
Re: Semi inox
philzgood a écrit:arthur a écrit:DagueHaubert a écrit:http://forum.neoczen.org/viewtopic.php?t=3648&highlight=107183&start=1
En fait je crois qu'on a déjà posé toutes les questions...
Ben non ! Heureusement !
Ma question était pourquoi appeler le 19C27 un semi-inox alors qu'il y a 13,5% de chrome dans l'alliage ?
C'est plus ça que je comprends pas !
Ben si,
Membre peu actif du PPP.
-

arthur - Plombier Plombé
- Messages: 5875
- Inscrit le: 24 Fév 2007 18:34
- Localisation: Ardeche sud
Re: Semi inox
Ben d'accord ! Excuse dérange 

C’est pas permis d’être aussi inintelligent que toi, tu sais ce que ça veut dire « inintelligent », espèce de con ?
R. Queneau - Zazie dans le métro
R. Queneau - Zazie dans le métro
-
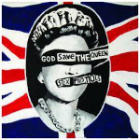
philzgood - Messages: 5047
- Inscrit le: 26 Aoû 2013 16:48
- Localisation: Paris
Re: Semi inox
cassca a écrit:ya longtemps qu'on a pas vu la video de mr stainless
http://www.dailymotion.com/video/x5bwu7 … rch_algo=2
Voilà !
°NO.
-
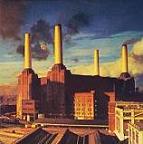
Woodtz - gazon maudit
- Messages: 10487
- Inscrit le: 02 Oct 2008 17:11
- Localisation: Metz
Re: Semi inox
freddy1 a écrit:C'est un peu de la vulgarisation scientifique parce que tu oublies la dynamique des fluides qui s' applique a cette temperature mais l'idée y est.…
Je ne sais pas si on peut vraiment parler de mécaniques des fluides, puisqu'on reste dans le domaine solide (aux températures qui nous intéressent), mais oui, il est certain qu'avec la température, l'agitation moléculaire augmente (par définition), rendant les migrations d'atomes plus faciles, et à l'opposé plus difficiles plus la température est basse. Il y a un terme pour ça que je n'ai plus vraiment en tête, il me semble que c'est quelque chose comme "phénomènes thermiquement activés". Mais souvent, les bons diagrammes TRC bien complets sont d'une aide précieuse, et aident pas mal à visualiser ces phénomènes, surtout si à coté on a des micrographies montrant la tronches des différentes "phases" (même s'il est un peu impropre d'appeler la perlite ou la bainite des phases), et qu'on garde en tête que fer α (la ferrite) a une maille cristaline cubique centrée (très peu de place pour le carbone et les éléments d'alliage), le fer γ (austénite) cubique face centrée (beaucoup plus de place), que les carbures (y compris la cémentite) sont un moyen pour évacuer du carbone et ainsi retomber sur une de ces deux structures stables, et que quand le refroidissement est suffisamment rapide, tout ce bousin n'a pas vraiment le temps de se réorganiser, et du coup c'est de la martensite qui se forme, qui a une maille centrée comme la ferrite (état stable à température ambiante), mais qui n'a pas eu le temps d'évacuer tout ce qui s'est mis dans les emplacements libérés lors de la mise en maille cubique face centrée, ce qui déforme la maille (qui cesse d'être cubique) et provoque en quelque sorte un tensionement de pré-contrainte augmentant considérablement l'énergie nécessaire à la création de dislocation du réseau cristalin (c'est le mécanisme par lequel l'acier se déforme plastiquement puis rompt), et de fait, dans l'acier trempé, la rupture se propage l'immense majorité du temps le long des joints de grains, souvent plus ou moins parsemés de carbures.
-

Madnumforce - Kaliméro
- Messages: 1092
- Inscrit le: 17 Mai 2010 20:18
71 messages • Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retour vers Discussions générales
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités